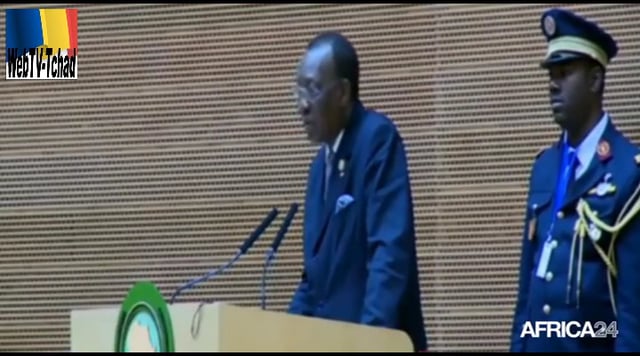Revue de Presse
(Livres – Débats – Idées)/ 2022 09 26/
EODE-BOOKS – lire – s’informer – se former
Un service du Département EDUCATION & RESEARCH
de l’Ong EODE
* trilogie LE MUSEE, UNE HISTOIRE MONDIALE
Krzysztof Pomian
(Gallimard
* Krzysztof Pomian
LE MUSEE, UNE HISTOIRE MONDIALE
tome II : L’ancrage européen, 1789-1850
Paris, Gallimard
« Bibliothèque des Histoires», 2021
REVUE DE PRESSE/
GEOPOLITIQUE DU MUSEE. UNE CONVERSATION AVEC KRZYSZTOF POMIAN
À l’occasion de la parution du dernier volume de sa trilogie Le Musée, une histoire mondiale (Gallimard), nous avons rencontré l’historien et philosophe franco-polonais Krzysztof Pomian. Dans cet entretien encyclopédique, il revient sur la géopolitique et l’histoire de ce lieu singulier inventé par les Européens pour conserver et exposer des œuvres, et dont la forme a ensuite largement voyagé et évolué : le musée.
* Pourquoi le musée a-t-il émergé en Europe plutôt que dans une autre région du monde, en Chine par exemple ?
C’est une question à laquelle il est bien évidemment très difficile de répondre. Mon hypothèse serait la suivante : à la fin du Moyen-Âge, il se produit en Europe à la fois la redécouverte d’une civilisation disparue, Rome, qui est aussi une projection de soi et qu’on avait oubliée pendant un millénaire ; et l’apparition d’un milieu de lettrés (d’intellectuels, dirait mon ami Jacques Le Goff), qui sont des laïcs et non plus des clercs. À cela s’ajoute la renaissance des villes, l’apparition de l’école et l’émergence d’une bourgeoisie urbaine, éduquée, dès les X-XIe siècles.
Aucun de ces phénomènes, à ma connaissance, ne s’est produit en Chine. En Chine, ce qui est frappant, c’est qu’il y a une continuité, qui favorise les collections particulières (un domaine où les Chinois sont plus avancés que les Européens, elles y existent sans discontinuer depuis fort longtemps). Le musée est aussi né pour la simple et bonne raison qu’il fallait mettre les antiquités à la disposition du public. C’est une idée qui a des racines anciennes. Elle est énoncée d’une manière extrêmement forte par Agrippa dans un texte que nous ne connaissons que par Pline — mais les Européens de la Renaissance connaissaient Pline, qu’ils avaient redécouvert. Pour mettre à la disposition du public ces œuvres, il fallait un lieu séculier, parce que c’étaient des objets païens. On a alors une conscience très élevée, qui se perdra par la suite, du caractère païen de ces objets romains.
À ma connaissance, ces conditions ne sont pas réunies en Chine où la continuité domine : la collection impériale grandit constamment, les collections des mandarins aussi, toute une série de rituels se développe, comme la cérémonie du thé avec la monstration des tableaux (les tableaux chinois ne sont pas suspendus comme les nôtres mais montrés déployés pendant une réception).
* Les trésors de l’Antiquité et du Moyen Âge, auxquels vous consacrez une part importante du premier volume de votre Histoire mondiale du musée, ont-ils constitué des sortes de musée avant la lettre ?
Les trésors sont un type de collection très spéciale en cela qu’ils sont des collections sans collectionneurs. Cela établit déjà une différence avec le musée, issu non pas du trésor mais de la collection particulière. C’est dans le contexte de la collection particulière qu’il apparaît. C’est pourquoi d’ailleurs son lieu de naissance est italien — romain en particulier — et non pas en Europe du Nord par exemple, où les trésors ne manquaient pas puisque toutes les dynasties en avaient.
Le musée est né pour la simple et bonne raison qu’il fallait mettre les antiquités à la disposition du public.
Le passage du trésor au musée va donc se faire par l’intermédiaire de la collection particulière. Mais l’importance des trésors est énorme : pendant une longue période, c’est la seule forme de collection. Au XIVe siècle, ils contribuent à éveiller chez certains individus ce qui est à la base de la collection particulière : un rapport personnel, individuel, émotionnel, parfois même existentiel aux objets. Nous connaissons quelques cas au Moyen âge de ce genre de rapports même s’ils sont en général insérés dans une perspective religieuse. Ensuite, les trésors vont jouer un rôle extrêmement important dans la constitution des musées. C’est vrai dans le cas des musées issus des collections dynastiques en Italie, celles des Médicis, des Este, des Gonzague, mais c’est plus flagrant encore dans le Nord, où partout, le musée va se nourrir du trésor C’est un processus qui s’étend sur une longue période, avec la fin des cabinets de curiosité princiers ; c’est le XVIIIe ,parfois même le XIXe siècle qui vont dépouiller ce qu’il reste des trésors. On le voit très bien à Berlin dans l’histoire de la Kunstkammer des rois de Prusse.
* Est-ce que le musée moderne, qui amalgame des œuvres sacrées et profanes et ouvre au public les collections princières, est le lieu où se négocie dans la culture collective le lien historique entre l’héritage monarchique ou impérial et l’âge démocratique, entre un passé chrétien et une société laïque ?
Je ne pense pas. Il me paraît plus juste de dire que ce qui se négocie là, c’est le rapport entre une culture séculière, au départ le paganisme ancien, et une culture chrétienne, mais pour parler de « démocratie » il faut aller très loin dans la Révolution française, et encore. On dit toujours que la Révolution ouvre le musée au peuple, en oubliant d’ajouter qu’il n’était ouvert que le dimanche, réservé pendant le reste de la semaine aux copistes et aux étrangers. C’est le Second Empire qui va faire ce premier pas très important dans la démocratisation du musée en l’ouvrant 6 jours sur 7 au public, en ménageant la cohabitation entre les visiteurs et les copistes.
* Vous montrez dans qu’il y a, entre le XVIIe et le XXe siècle, une explosion du nombre de musées qui s’accélère avec le temps, de Rome et de l’Europe vers le monde, et notamment l’Amérique. Assiste-t-on aujourd’hui au trajet inverse ?
Oui et non. Il y a un évident retour, qui commence lentement après la Première Guerre mondiale mais s’implante vraiment après la Seconde Guerre mondiale, avec une influence des musées américains sur leurs correspondants européens. Elle ira crescendo entre les années 1940 et les années 1980. Elle concerne notamment les innovations techniques mais surtout l’attitude non pas élitiste mais démocratique, accueillante face à un public de masse . Dans les années 1980, la différence s’estompe, mais quand j’ai commencé à m’y intéresser, lors de mon premier séjour aux États-Unis en 1974, la différence était quand même assez frappante entre le Metropolitan ou la National Gallery de Washington et le Louvre. Avec le Grand Louvre, cet écart a complètement disparu. Désormais le Louvre n’a plus grand-chose à apprendre des Américains.
Désormais le Louvre n’a plus grand-chose à apprendre des Américains.
Mais il y a un deuxième aspect de cette question, infiniment plus difficile à cerner parce qu’il se joue sous nos yeux. Nous assistons, dans plusieurs musées extra-Européens, océaniens en particulier mais aussi néozélandais, australiens, canadiens et américains, à une nouvelle attention à la contribution indigène, amérindienne ou aborigène, à côté de la contribution européenne. Or, si vous associez les Maoris à la gestion de leurs collections, qui proviennent de leur civilisation (ce qui semble n’être que justice), vous devez négocier la question de l’accès aux objets qui, dans la culture tribale, sont inaccessibles aux femmes ou à des personnes qui n’ont pas été initiées. Cela doit-il s’appliquer uniquement aux peuples premiers ou aussi aux Européens ? Comment gérer le public dans cette situation ? Je ne doute pas que nous trouverons bientôt en Europe, avec l’avancée de la pensée décoloniale, des gens qui diront qu’il faut interdire l’accès à certains objets du Quai Branly-Jacques Chirac à des personnes qui ne sont pas initiées, mais on risque d’assister ici à une caricature. Pourtant, dans certaines sociétés, le problème se pose d’une cogestion entre Européens et peuples premiers.
Le Canada a su résoudre intelligemment ce problème. Cela dépend aussi beaucoup des musées. À Vancouver, les chefs tribaux de la côte nord-ouest ont voix au chapitre dans la gestion du musée et participent à une sorte de conseil, peuvent organiser des cérémonies à l’intérieur du musée mais laissent la conservation des objets aux conservateurs du musée. À Wellington, il y a déjà des Maoris formés comme conservateurs, à la fois gardiens de la tradition locale et conservateurs à l’européenne. Mais des frictions entre l’attitude, disons pour faire bref, européenne et l’attitude indigène apparaissent ; elles sont inévitables, surtout au départ. Reste à espérer qu’elle vont s’estomper avec le temps.
Enfin, l’effet retour de cette question sera lié à la question des restitutions. Si l’on sort d’une définition restreinte, juridique, nous sommes face à un problème plus large qui consiste à solder l’héritage impérial et colonial. Ça vaut autant pour le passé de la Russie dans ses rapports avec les peuples d’Europe orientale et centrale que pour le passé de la France dans ses rapports avec l’Afrique. Là, il y a un énorme problème, auquel les musées réagissent en ordre dispersé, parfois de manière un peu panique, je pense. Mais il faudra trouver des solutions. Personnellement, j’ai toujours été partisan des discussions bilatérales sur ces sujets. Je suis confiant, les solutions existent. Cela va nécessiter beaucoup de bonne volonté de part et d’autre, et cela ne pourra se faire que dans un climat apaisé.
* On parle souvent de négociations bilatérales au sujet des restitutions mais est-ce que les restitutions pays par pays ne sont pas une forme de simplification, qui attentent in fine à la portée universelle ou du moins transnationale du musée ?
Il faut distinguer deux choses. D’une part, l’état dans lequel restera le musée du Quai Branly-Jacques Chirac après que nous aurons restitué après des accords bilatéraux – et là, rien n’empêche que le musée conserve sa perspective universaliste et que nous parlions de l’art africain, ou océanien, en général. Et d’autre part, les négociations elles-mêmes, dans lesquelles nous avons affaire à des pays et des gouvernements. Dans le cas français, nous avons affaire à l’ancienne Afrique française, désormais composée de plusieurs États qui à des degrés différents attachent une importance à ce patrimoine. On ne peut donc pas faire autrement que d’engager des négociations bilatérales. Ces objets, nous connaissons désormais bien leurs origines, ce ne sont pas des objets africains in abstracto, ce sont des objets qui viennent de peuples, d’ethnies, de tribus qui vivent parfois à cheval sur deux États. Mais c’est avec les États que nous devons négocier. Cela n’exercera cependant aucune influence sur la manière d’exposer et de traiter ce qui restera à terme dans les musées européens. Même avec une perspective universaliste, nous distinguons déjà les objets en fonction de leur provenance, nous essayons quand c’est possible d’identifier les artistes comme nous le faisons pour l’art européen, même si ce n’est pas toujours faisable faute de sources, de documentation écrite.
* Est-ce que ce problème de la restitution, cette dialectique du prendre et du rendre, est quelque chose qui définit cet âge contemporain du musée dans lequel on vit ? Est-ce que le musée moderne est aujourd’hui nécessairement condamné, au moins en Occident, à devoir en permanence négocier à la fois la question de l’origine de ses collections et celle de leur restitution éventuelle à ceux auprès de qui elles auraient été spoliées ?
Le bon sens, qui a triomphé dans ce domaine, a permis de se dire que nous n’allons pas nous poser la question des restitutions à l’infini. Personne n’a demandé jusqu’à maintenant que la France restitue les objets arrivés à Paris en conséquence de la quatrième croisade, puis exposés à la Sainte Chapelle et dont certains sont toujours là aujourd’hui.
En fait, le problème des restitutions ne se pose réellement qu’à partir du XVIIIe siècle. Personne n’a essayé de récupérer tous les objets qui ont été pillés pendant la guerre de Trente ans ! Nous savons aujourd’hui à l’unité près l’histoire de ces objets, dont certains sont en Australie ou aux États-Unis. Mais personne ne prétend qu’il faille les réunir tous, les envoyer à Stockholm d’abord pour qu’ensuite les Suédois les retournent à Prague, puisqu’en général ils viennent de la collection de Rodolphe II. La question des restitutions commence à se poser avec Emerich de Vattel et son Droit des gens (1758) qui le premier énonce très clairement le principe selon lequel les pillages des biens culturels sont contraires aux fondements mêmes des relations entre les peuples civilisés et n’ont donc pas lieu d’être.
Je ne doute pas que nous trouverons bientôt en Europe, avec l’avancée de la pensée décoloniale, des gens qui diront qu’il faut interdire l’accès à certains objets du Quai Branly-Jacques Chirac à des personnes qui ne sont pas initiées, mais on risque d’assister ici à une caricature.
Cette idée juridique, qui est liée directement à mon avis à l’apparition du musée, à une sorte de nationalisation mentale des œuvres d’art avant même qu’elles ne soient nationalisées juridiquement, va aboutir après les guerres napoléoniennes aux restitutions. Il y a eu encore quelques hésitations au moment du Congrès de Vienne, ce qui montre que ses participants étaient encore un peu dans un monde ancien, mais après Waterloo il n’y avait plus de débat possible – les œuvres ont été restituées, créant un précédent qui jouera un rôle tout-à-fait essentiel au cours de la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes là dans un monde façonné par les Lumières et la tradition juridique du XVIIIe siècle.
* Que dire des demandes de restitutions qui mettent précisément l’accent sur la dimension juridique de leur revendication et à qui on oppose encore fin de non-recevoir ? On peut penser au cas de la Grèce, et de son litige avec le Royaume-Uni. Le droit semble être du côté britannique mais l’esprit des Lumières ne voudrait-il pas que l’on conçoive la collecte des marbres du Parthénon comme un pillage ?
En ce qui concerne les marbres du Parthénon, à mon avis la Grèce n’a aucun titre juridique pour réclamer leur restitution. Mais le droit, hélas – c’est son défaut majeur – est fait pour les vainqueurs. Il sanctifie le statu quo. Éthiquement, je serai d’avis qu’il faut trouver un arrangement entre la Grèce et le Royaume Uni, un prêt de longue durée par exemple. Avec un peu de bonne volonté, on devrait trouver quelque chose. Encore une fois, l’argumentation grecque, qui est une argumentation juridique et qui s’est développée depuis le XIXe siècle autour de cette affaire, ne tient pas la route : l’idée selon laquelle le sultan ottoman n’avait aucun droit de céder ces pierres est absurde ! La Grèce faisait à l’époque partie de l’Empire ottoman.
Évidemment, il reste tous les problèmes des œuvres qui se trouvent en Russie et qui ont des origines hongroises, bulgares, parfois même italiennes, mais qui ont été transportées par les nazis sur des territoires qui ont ensuite été libérés par l’Armée rouge, puis apportés en Russie. Les juristes soviétiques, avec qui il m’est arrivé de parler, juraient leurs grands dieux que tout ce qui se trouvait désormais en Russie était parfaitement disponible et accessible. Je demeure extrêmement sceptique sur ce point. Jamais un travail d’ampleur n’a été conduit pour procéder à l’inventaire de tous les biens culturels arrivés en Russie à la faveur de la Seconde Guerre mondiale. Ils sont perçus comme des témoignages de la victoire soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. C’est là une position qui me paraît très problématique, tant du point de vue éthique que juridique !
* Si on regarde cette période du premier XIXe siècle, où les diplomates européens se piquent d’archéologie dans l’espace ottoman, et qu’on se pose cette question du rapport du droit à l’éthique aujourd’hui dans le débat sur les restitutions – est-ce que vous diriez la même chose à propos de la Vénus de Milo, des objets assyriens rapportés par Austin Layard et Paul-Émile Botta, des antiquités romaines rapportées d’Algérie dans les années 1840, de tous ces objets que les diplomates et militaires français et britanniques pour la plupart sont allé collecter dans les territoires ottomans au moment où les puissances européennes établissaient leur emprise sur ces différents territoires ?
Encore une fois, juridiquement ces cas sont incomparables. Pour expatrier la Vénus de Milo ou la Victoire de Samothrace, des ambassadeurs demandaient la permission et l’ont reçue. Lorsque Newton veut faire des fouilles à Halicarnasse, il demande la permission. Il demandera aussi la permission d’exporter les objets et il l’obtient. Il faudra du temps pour que les Ottomans se posent la question de conserver ces objets. C’est d’ailleurs dans ce contexte que commence à germer l’idée d’un musée des antiques à Istanbul.
Jamais un travail d’ampleur n’a été conduit pour procéder à l’inventaire de tous les biens culturels arrivés en Russie à la faveur de la Seconde Guerre mondiale.
Pour ce qui est de l’Algérie, c’était la France. Il n’y avait donc aucune difficulté à transporter des antiquités françaises d’un bout du pays à l’autre. Il faut encore une fois distinguer les choses : juridiquement parlant, il n’y a pas de contestation possible. À partir de là, il faut étudier chaque cas à part et voir ce qui peut ou doit être fait. En Tunisie, par exemple, on a bien équipé le musée du Bardo et il n’y a aucun problème de ce côté-là.
* L’histoire des musées est-elle consubstantiellement liée à l’histoire des grandes villes ?
Absolument. Et de ce point de vue-là, les États-Unis sont encore un meilleur exemple que l’Europe. Le Metropolitan Museum, en théorie géré par le Board of Trustees, est en certain sens une entreprise privée mais est en même temps une institution centrale de l’identité new-yorkaise, comme l’Art Institute l’est pour Chicago, le LACMA pour Los Angeles, ou le De Young pour San Francisco. Les musées sont des institutions essentielles des identités urbaines. Il suffit pour s’en convaincre d’essayer d’y toucher. N’importe quelle affaire – je ne parle même pas d’installer une pyramide de verre dans la cour Napoléon du Louvre ! – que ce soit à Varsovie, à Gdansk, ou ailleurs, génère immédiatement des réactions émotionnelles énormes. On a essayé une fois de déplacer les Mantegna de Tours à Paris : la tentative a été liquidée en l’espace d’une semaine ! Les musées font intégralement partie des villes et de leurs identités.
* Est-ce que les musées sont aussi des outils de construction de l’identité nationale ou même parfois, comme ça peut être le cas aujourd’hui aux États-Unis, de déconstruction de cette identité ?
Non, il n’est pas dans l’intention du Louvre de raconter l’histoire de France. Et pourtant, le lien du Louvre à l’histoire de France est particulièrement flagrant à la fois parce que c’est un palais aux racines profondes et que l’ouverture du musée tient une place essentielle dans l’histoire de la Révolution. Le Louvre, c’est donc aussi le concentré de l’histoire de France, depuis la partie des murs qui remontent aux Capétiens jusqu’au plafond de Cy Twombly. Vous n’y pouvez rien d’une certaine manière, cela ne dépend de personne, c’est comme ça.
On voit qu’il y a un lien entre iconoclasme et musée dès le XVIIIe siècle, lorsqu’on met au musée les œuvres qu’on veut soustraire au « vandalisme » révolutionnaire. Aujourd’hui, on voit qu’il y a tout un courant qui veut attaquer les monuments publics mais aussi les monuments qui se trouvent à l’intérieur ou autour du musée – la statue de Theodore Roosevelt devant le American Museum of Natural History de New York, par exemple. Quelle est votre perception de ces questions-là, de la manière dont l’iconoclasme, hier et aujourd’hui, croise l’histoire et la fonction du musée ?
Je ne pense pas que l’utilisation du terme « iconoclasme » soit tout à fait pertinente. Je viens de lire un article sur l’histoire de l’enlèvement de la statue de Napoléon à Rouen et la proposition de son remplacement par une effigie de Gisèle Halimi. Nous n’avons pas là affaire à un iconoclasme mais plutôt à une tentative, qui me paraît très grave, de réécrire l’histoire de France — ou des États-Unis dans le cas de Teddy Roosevelt. On peut penser ce qu’on veut de Roosevelt, un impérialiste dont il serait difficile de défendre le bilan aujourd’hui, mais ce à quoi nous assistons dans ces opérations dites décoloniales, c’est en fait à des tentatives de refaçonner l’histoire, de faire en sorte que l’histoire telle qu’elle a eu lieu disparaisse et soit remplacée par une autre.
Ce à quoi nous assistons dans ces opérations dites décoloniales, c’est en fait à des tentatives de refaçonner l’histoire, de faire en sorte que l’histoire telle qu’elle a eu lieu disparaisse et soit remplacée par une autre.
La chose devient, je vous l’accorde, beaucoup moins discutable dans le cas des généraux de la Confédération. Il y a des monuments dont il faut probablement savoir se débarrasser, comme on l’a fait d’ailleurs à la sortie du régime communiste dans les pays anciennement soviétisés, en mettant ces différents monuments dans des sortes de parcs – de musées de plein air en fait. Ils gardent la mémoire mais ne célèbrent plus. La chose devient infiniment plus compliquée dans le cas de Napoléon, dont le rôle libérateur est tout aussi important – si ce n’est plus – que le fait qu’il a rétabli l’esclavage. Il faut être extrêmement prudent. Mais, encore une fois, nous n’avons pas affaire à un iconoclasme mais à une tentative de ratiboiser l’histoire telle qu’elle a été pour la remplacer par une autre.
* Étant l’endroit où l’on peut passer de la célébration à la mémoire, le musée n’est-il pas justement le lieu idéal pour refroidir les débats, aborder les questions avec pédagogie et réfléchir à l’histoire ?
Certainement. C’est un lieu où en principe ces significations doivent être neutralisées. Mais cela suppose aussi l’acceptation de certaines règles du jeu, et notamment d’une grande leçon que le musée nous a donnée, à savoir que l’idée que votre regard puisse être « blessé » n’est pas acceptable. Nous ne pouvons pas accepter de retirer certains objets parce que certaines personnes prétendent que ces objets heurtent leur regard. Tout le problème réside aujourd’hui dans la résurgence sectaire et rétrograde d’une rhétorique du regard offensé, pourtant inacceptable.
Une question a été posée à Francis Haskell il y a trente ans, au cours d’une conférence qu’il donnait à Florence sur le sujet des ennemis du musée, de Quatremère de Quincy à la contre-culture. Parce qu’on mesure qu’en trente ans, les arguments contre le musée ont largement évolué, nous vous reposons alors la même question : que répondez-vous à ceux qui souhaitent la destruction du musée ?
Je suis absolument, radicalement et fermement hostile à l’idée de l’abolition du musée. À ceux qui souhaitent sa destruction, je réponds d’abord, dans un mouvement d’indignation, qu’ils sont des barbares – ce qui n’est pas un argument, nous sommes bien d’accord. Je répondrai donc ensuite que les sociétés modernes, telles que la nôtre, ne peuvent tout simplement pas exister sans une institution telle que le musée. La preuve en est, de nouveau : essayez de vous attaquer au musée et vous verrez la réaction ! Lorsque pendant la Seconde Guerre mondiale, dans beaucoup de pays, les musées ont été fermés ou interdits, les gens en ont été profondément malheureux. Une des premières choses qui ont été faites à Varsovie, pourtant dans un état de ruine inimaginable, au sortir de la guerre, c’était la réouverture du musée. Notre culture trouve son temple dans le musée. Nos dieux lares se trouvent là. Touchez-y seulement et il vous en cuira !
* Le dernier tome de L’Histoire mondiale du musée est consacré à la « conquête du monde », de 1850 à 2020. Pouvez-vous revenir sur les caractéristiques de cette période, marquée par l’ouverture des collections des musées européens aux œuvres du monde entier ainsi que par l’exportation du modèle même du musée aux autres continents ?
Les deux phénomènes sont liés.
D’une part, entre le XIXe et le XXe siècles, on voit entrer au musée des objets de toutes les provenances géographiques, ce qui entraîne un changement de leur statut en cours de route.. De curiosités recueillies dans des cabinets privés, ces objets deviennent dans les musées des documents ethnographiques, révélateurs de civilisations, cultures, ou sociétés différentes de la nôtre. Enfin, à terme, presque tous deviennent des œuvres d’art.
Il y avait, certes, des précédents égyptiens et mésopotamiens. Ces objets-là, présents dans l’horizon européen depuis au moins le XVe siècle, étaient entrés au musée dès les premières décennies du XIXe mais ils renvoyaient à des aires connues par l’entremise de la Bible. Ici, nous parlons des sociétés qui n’ont aucun lien avec l’ancienne tradition européenne et dont les objets acquièrent au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle le statut d’œuvres d’art : d’abord les objets japonais, puis islamiques, puis précolombiens relativement bien connus, mais justement en tant que monuments historiques ou curiosités ethnographiques ; c’est ensuite la Chine, puis l’Inde, enfin l’Océanie et l’Afrique. L’art chinois était bien connu depuis le XVIIIe siècle, mais on lui attribuait une fonction décorative. On n’y voyait pas encore du grand art.
L’art japonais est perçu d’emblée comme le grand art et comparé aux productions européennes. Des écrivains lui confèrent ses lettres de noblesse, comme les Goncourt et bien d’autres. On peut dater ce phénomène des années 1860, en même temps que la première participation du Japon aux Expositions universelles.
Quarante ans plus tard, Apollinaire écrit un article où il exige, pour les objets océaniens et africains, ce qu’on appelait à l’époque « l’art nègre », le statut d’œuvres d’art. Il dénonce l’état lamentable du musée d’ethnographie du Trocadéro, vétuste et mal gardé. Pour ces objets-là, la promotion à la dignité de l’art prendra plus de temps en France, avant de se voir accomplie dans le Pavillon des Sessions du Louvre organisé par Jacques Kerchache, et finalement au musée du Quai Branly-Jacques Chirac – réalisation du vœu d’Apollinaire.
L’autre face de cette mondialisation, c’est la propagation du musée hors d’Europe occidentale qui commence par sa pénétration en Europe centrale et en Russie. Et qui est portée par la colonisation européenne avec l’installation du musée, d’abord dans des sociétés de migrants venus d’Europe, sociétés de tradition chrétienne filtrée et recomposée par les Lumières – Etats-Unis d’Amérique, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Amérique hispanique et lusophone –, puis, plus récemment, dans des sociétés indigènes, celles des Peuples Premiers , porteurs des traditions propres, fussent-elles influencées par la cohabitation forcée avec les Européens, où le musée rencontre des problèmes tout à fait différents de ceux qu’il rencontrait en Europe et dans les Europes hors d’Europe. Pendant la première phase, les Européens exportent le musée avec la conquête coloniale, à tel point est-il est devenu pour eux une institution indispensable. En Australie, le premier musée est créé avec des subsides anglaises dès les années 1820. En Inde, dès la création de la Société Asiatique à la fin du XVIIIe siècle, un musée est prévu, qui ne verra le jour à Calcutta que dans les années 1820. C’est un cas exceptionnel, car les savants locaux, les Bengalis, sont admis dans la Société Asiatique. Et que – comme le montrent les registres du musée de Calcutta qui divisent son public selon la couleur de peau et le sexe – le musée était fréquenté surtout par des visiteurs locaux dont 20 % à peu près de femmes. En Amérique du Centre et du Sud, les musées sont créés dans un pays après l’autre suite à leur accession à l’indépendance.
Un chapitre essentiel de cette histoire se déroule aux États-Unis. Il commence là encore à la fin du XVIIIe siècle avec un musée à Charleston, puis se poursuit ensuite après l’indépendance. Mais les pères fondateurs n’arrivent pas à introduire dans la Constitution fédérale une obligation pour l’État fédéral de financer les institutions culturelles, qui se trouvait pourtant dans les constitutions de certains États, comme le Massachusetts. La majorité des rédacteurs de la Constitution y est opposée, jugeant que ce n’était pas à l’État de fournir des distractions que les gentlemen pouvaient se payer de leur poche, s’ils le souhaitaient. L’Etat fédéral se verra néanmoins embarqué dans la gestion des musées à partir du moment où le Congrès accepte, après de longs et orageux débats, le legs fait au peuple des Etats-Unis par un richissime savant anglais, James Smithson, et crée en 1846 la Smithsonian Institution « pour l’accroissement et la diffusion du savoir parmi les hommes ». Elle avait au départ un musée ; elle en a aujourd’hui dix-neuf.
Mis à part le cas de la Smithsonian, les musées sont créés aux États-Unis des sept premières décennies de XIXe siècle soit par des individus, soit par des associations, toujours avec des financements extrêmement précaires. Aussi disparaissent-ils assez rapidement ou sont obligés, pour certains, de devenir des entreprises de divertissement, tout simplement pour attirer le public.
Au lendemain de la guerre de Sécession, une dynamique économique sans aucun équivalent au monde, propulsée par des subventions du Congrès qui donne aux compagnies ferroviaires des terres pour presque rien, dans un contexte où la législation du travail n’existe pas, où une immigration encouragée agit à la baisse sur les salaires, et où le réseau ferroviaire qui se développe permet une meilleure exportation des produits agricoles et industriels. Dans ce cadre, d’immenses fortunes se créent à très grande vitesse. Chez les riches, la collection privée devient une mode. De très belles maisons sortent de terre à New York et ailleurs. La rivalité entre les villes pousse chacune d’elles, à construire les musées suivant l’exemple de Boston, New York, Philadelphie, Chicago. Aux environs de la Première Guerre mondiale, le musée arrive en Californie et au Nouveau-Mexique. De ces musées, plusieurs acquièrent rapidement une importance internationale, le mécénat privé leur offrant des moyens d’acquisition des œuvres qu’à l’époque les musées européens, avec leurs budgets très restreints, n’ont pas.
À partir du milieu du XIXe siècle, les musées commencent aussi à s’installer dans l’Empire ottoman. Les Ottomans n’ont aucune tradition de collections particulières et ne considèrent pas au début comme appartenant à leur passé les objets qu’on trouve dans les fouilles en Anatolie à l’époque. C’est un travail sur soi, un travail identitaire qui va permettre aux Turcs de considérer les ruines grecques comme faisant partie de leur patrimoine. Il en va semblablement en Égypte, où il s’agit de convaincre les Egyptiens que le passé pharaonique est le leur, alors qu’ils sont une nation musulmane dont l’histoire commence supposément avec l’Hégire. Au départ, ils se sentent étrangers à ces idoles de l’ancienne Égypte dont le caractère païen est manifeste, avant d’y voir un élément essentiel de leur passé. Dans cette acclimatation des objets à un nouveau statut et à un nouveau contexte culturel, politique, patrimonial, le musée joue un rôle essentiel.
A l’autre bout du continent, le musée arrive au Japon. À la fin du XIXe siècle, les Japonais se mettent à étudier le fonctionnement des nations occidentales pour mieux en maîtriser les codes et les armes. Ils envoient des missions en Europe et aux Etats-Unis avec des listes d’institutions à comprendre et à apprendre : à côté de l’armée prussienne et de l’École polytechnique, y figurent les musées, car, pensent-t-ils, le musée a quelque chose à voir avec la puissance occidentale. Leurs envoyés iront ainsi au British, au Louvre, aux musées de Berlin, à l’Ermitage en Russie, tout en visitant les usines, les casernes, les prisons et tout le reste.
Dans la frénésie de la révolution de Meiji, en 1868, un très grand nombre d’objets japonais passent aux mains de collectionneurs américains qui sont sur place. Ceux-ci forment d’immenses collections tout en introduisant l’idée, auprès des autorités locales, de la nécessité de lois pour la protection de leur patrimoine. Avant que l’exportation des œuvres d’art ne soit formellement interdite, de grandes collections d’art japonais se forment déjà aux Etats-Unis.
Dans le même temps, certains hauts fonctionnaires de l’administration japonaise, passés par l’Europe et les Etats-Unis, sont à l’origine d’un premier “bureau muséographique” au Japon – un équivalent du mot « musée » étant inventé en japonais par la même occasion. Ce sera le début d’un mouvement qui ira très vite puisque, vers 1930, on compte déjà trois centaines de musées à travers l’archipel.
Enfin en Chine, il faut attendre la révolution de 1911 pour voir apparaître les premiers musées. Auparavant, il en existe déjà quelques-uns , créés par les étrangers, surtout par les missionnaires, mais la première institution muséale véritablement chinoise ne voit le jour qu’en 1912. Après la révolution, les collections impériales sont nationalisées et au moment de l’invasion japonaise, on compte déjà deux centaines de musées en Chine.
Le Conseil international des musées (ICOM) vient de proposer une nouvelle « définition » du musée, qui ne se limite plus à la préservation, la protection, la mise à disposition du public et la valorisation des collections, mais met l’accent sur le service de la communauté et l’inclusion des publics les plus divers. Comment interprétez-vous ce changement de doctrine ?
Comme un changement idéologique. D’abord, ce n’est pas une définition au sens que la logique donne à ce terme. C’est une tentative de préciser les critères d’admission d’un musée à l’ICOM ce qu’il est pleinement en droit de faire. La précédente définition elle-même n’était d’ailleurs pas non plus une définition à proprement parler. Ces propositions ne disent pas ce qu’est un musée ; elles disent ce qu’il devrait être pour satisfaire aux critères de l’ICOM en accord avec la dernière mode idéologique et rhétorique, qui privilégie les mots tels qu’« inclusif », « diversité », « communauté ».
Le grand défaut de la « définition » de l’ICOM est de mettre sur le même plan l’essentiel et l’accessoire. Le musée est centralement une collection – mot absent du langage de l’ICOM – préservée pour un avenir indéfiniment lointain mais exposée à présent au public. Une collection séculière, détachée de tout culte religieux mais qui peut être investie de significations idéologiques. Le rôle principal du musée est de la conserver, de l’étudier, de concilier les exigences contradictoires de la conservation, et de l’exposition. Sur cette fonction définitoire se greffent d’autres, secondaires et transitoires, comme celles dont l’ICOM parle aujourd’hui, dont il ne parlait pas hier et qu’il oubliera demain.
* Voyez-vous une trajectoire historique se dessiner des premières définitions du musée au XVIIIe siècle jusqu’à cette récente proposition de l’ICOM ? Au cours de ces deux-cent dernières années, le musée a-t-il changé de destination ?
La réponse dépend de ce qu’on entend par « destination ». Pendant longtemps, le musée d’art était destiné aux connaisseurs, le musée d’histoire naturelle, aux naturalistes. L’un et l’autre étaient ouverts à tous mais l’accrochage, la mise des objets en vitrines, les cartels, etc. définissaient en fait le public visé. Cela a complétement changé d’abord aux Etats-Unis, plus tard en Europe. En ce sens, le musée a changé de destination. Mais cela s’est fait dans la pratique muséale justifiée a postériori, il est vrai, par des considérations idéologiques y compris des « définitions » du musée.
Il vous est arrivé, dans d’autres textes ou d’autres entretiens, de définir l’Europe comme le continent de la transgression. Croyez-vous que cette définition soit encore valable aujourd’hui ? Dans le paysage culturel mondialisé que vous décrivez, l’Europe ne semble pas être l’endroit le plus transgressif aujourd’hui.
L’Europe n’est certainement plus l’endroit le plus transgressif qui soit, encore qu’elle puisse, parfois, se montrer toujours un peu transgressive. Mais les choses les plus intéressantes et les plus novatrices dans le domaine dont nous parlons ici ne se passent plus en Europe. Les problèmes nouveaux que rencontrent les musées émergent de géographies bien différentes : là où ils doivent s’adapter à des sociétés où le musée entre en conflit avec les croyances qui gardent encore une emprise sur les esprits.
Le musée est inséparable de la sécularisation des mentalités, il suppose une neutralisation de l’objet religieux, sa perception comme œuvre d’art ou monument historique, sans quoi toutes les vierges, toutes les crucifixions ne seraient pas au Louvre mais dans les églises. Or les sociétés que les musées rencontrent maintenant – je pense aux sociétés océaniennes, à certaines sociétés africaines, ou même au monde musulman qui oppose au musée une résistance, au sens où c’est l’aire culturelle la moins muséifiée qui soit – leur demandent de s’adapter à de nouvelles exigences : de respecter certains interdits, de composer avec certaines traditions incompatibles avec ce que le musée est depuis des siècles. Peut-on interdire l’accès au musée à certains objets à des personnes qui ne sont pas initiées ? Peut-on empêcher les femmes ou les femmes enceintes tenues pour impures d’entrer au musée ou de voir certains objets ? Chaque société est libre de décider sur ces points mais il faut bien voir que la réponse affirmative à ces questions dénature le musée au sens où elle le transforme en un espace sacré.
Dans les années soixante, en Inde, on voyait encore des gens venir fleurir les statues, déposer des offrandes à leur pied dans les musées : ils ne faisaient pas la distinction entre le temple et le musée. On ne doit pas s’étonner que les Peuples Premiers aient toutes les peines du monde à saisir la spécificité de cette étrange institution. Les Européens ont mis quelques siècles à l’apprendre. Cela prendra du temps. Comme disait Bergson, il faut attendre que le sucre fonde. Il ne faut rien imposer, rien précipiter. Nous devons accepter des compromis. Mais je crois aussi que nous ne devons pas aller jusqu’à transformer nos musées en fonction des exigences des Peuples Premiers. Je crains que là-dessus l’ICOM, pour en revenir à lui, ne se montre pas très clair.
Source :
_____________________
# EODE-BOOKS …
eode.books@yahoo.com
http://www.eode.org/category/eode-books/
EODE ORGANISATION …
# EODE-TV :
* EODE-TV sur YouTube :
https://www.youtube.com/user/EODEtv
* Page Officielle EODE-TV
https://www.facebook.com/EODE.TV/
# ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ЗА ДЕМОКРАТИЮ И ВЫБОРЫ (ЕСДВ)/
EURASIAN OBSERVATORY FOR DEMOCRACY & ELECTIONS
(EODE) :
http://www.eode.org/
https://www.facebook.com/EODE.org /
https://www.facebook.com/groups/EODE.Eurasie.Afrique/
https://www.facebook.com/EODE.africa/
https://www.facebook.com/EODE.russia.caucasus/
# GROUPE OFFICIEL ‘EODE – AXE EURASIE AFRIQUE’
https://www.facebook.com/groups/EODE.Eurasie.Afrique/